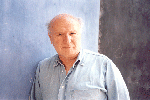DEUX LANGUES
MAIS UNE SEULE RECHERCHE
par Yves Bonnefoy
On dit volontiers aujourd’hui que notre parole va son chemin sans rencontrer jamais d’aspects du monde ou de situations de la vie qui échapperaient à sa prise et néanmoins nous pénétreraient d’une vérité qui leur serait propre. Le réel ne serait selon cette vue que le produit du langage. Est-ce vrai ? Oui, pour ce qui est des objets, en cela artificiels, à l’aide desquels nous avons bâti notre lieu, mais ne s’attacher qu’à ceux-ci, et aux événements qui s’y articulent, serait ne pas tenir compte des moments pourtant innombrables qui, au contact de la réalité naturelle, bouleversent nos systèmes de représentation et nous font ainsi percevoir dans la profondeur de notre rapport à nous-mêmes des dimensions que recouvre la pensée qui se fait langage et, dans cet espace des mots, se voue au concept. Qu’une nuée se déchire, par exemple, qu’un rayon de soleil se glisse entre ces deux masses d’ombre, et voici que quelqu’un en nous s’éveille à une expérience de l’instant – du temps transfiguré par l’instant – qui à la fois nous dit notre finitude et comment celle-ci peut-être vécue comme autre que le manque et même l’énigme que l’existence qu’enchaîne le discours uniquement conceptuel croit devoir constater dans ce qui est.
Le vrai, c’est que le langage est environné par une réalité qui l’excéde mais non sans le dominer de ses cimes, visibles du lieu même où nous nous cherchons parmi les mots et leurs choses; et c’est aussi qu’il y a entre ce premier plan, notre parole ordinaire, et cet arrière-plan, tout d’unité, de simplicité, mille chemins d’abord pavés puis herbeux sur lesquels la recherche humaine peut s’engager : une pente, bien vite abrupte, c’est sur, qu’on peut dire la poésie. – Et ce fait incite à une question, entre beaucoup d’autres, une question qui, dans ce champ de la conscience fondamentale, me paraît devoir être la réflexion obligée de toute poétique moderne, en ce temps où aucune langue n’existe plus, au fond de la vallée que j’évoque, sans une connaissance et une pratique toujours accrues de nombre des autres langues, que rapproche d’elle la multiplication des échanges.
Cette question, c’est – pour en rester à ma métaphore – celle des chemins, des sentiers qu’en chaque langue les poétes ont découverts ou frayés aux marges les plus lointaines de son emploi notionnel afin d’essayer d’aller vers ce grand réel indéfait et chargé de feux qui se profile au-delà de leurs moyens – de leur aliénation – linguistiques. Ces chemins sont-ils en toutes les langues les mêmes ? Certaines de ces dernières n’ont-elles pas, du fait de quelques-uns de leurs caractéres – nés eux-mêmes d’une relation nécessairement singulière à leur lieu physique -, accés à des raccourcis, vers le haut rebord si abrupt ? Tandis que d’autres bénéficieraient de trajets plus longs mais alors ombreux et parfois presque riants vers la même cime à des moments dérobés sous le feuillage des choses ? En bref, n’y a-t-il pas autant de savoirs, de pratiques du monde, spécifiquement poétiques que de langues, ou de familles de langues ? Avec, ici ou là, des lambeaux d’expériences du grand objet extérieur qu’il serait aussi passionnant qu’utile d’identifier, par l’étude comparative des grandes oeuvres de la poésie de chacune ?

portrait de Alechinsky